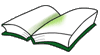A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
Détail de l'auteur
Auteur Jérôme Janicki
Documents disponibles écrits par cet auteur

 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheRetour sur un phénomène judiciaire passé / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 403 (Avril 2011)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 403 (Avril 2011) . - p. 35-39
Titre : Retour sur un phénomène judiciaire passé : les infanticides des nouveau-nés (1850-1900) Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Jérôme Janicki Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 35-39 Langues : Français (fre) Mots-clés : Enfant Histoire Infanticide Mères Mort Nouveau-né Obstétrique Résumé : L'infanticide des nouveau-nés est un fait difficile à cerner qui cause des dommages irréversibles dans les familles et dans la société. Attirée épisodiquement par ces actes insupportables, la presse livre des récits éclatés et amorce souvent un débat empreint de lyrisme qu'elle alimente jour après jour. Ce fut le cas dans les affaire Vandeput en 1962, Courjault en 2006 ou de Villers-au-Tertre en juillet 2010. [article] Retour sur un phénomène judiciaire passé : les infanticides des nouveau-nés (1850-1900) [Livres, articles, périodiques] / Jérôme Janicki . - 2011 . - p. 35-39.
Langues : Français (fre)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 403 (Avril 2011) . - p. 35-39
Mots-clés : Enfant Histoire Infanticide Mères Mort Nouveau-né Obstétrique Résumé : L'infanticide des nouveau-nés est un fait difficile à cerner qui cause des dommages irréversibles dans les familles et dans la société. Attirée épisodiquement par ces actes insupportables, la presse livre des récits éclatés et amorce souvent un débat empreint de lyrisme qu'elle alimente jour après jour. Ce fut le cas dans les affaire Vandeput en 1962, Courjault en 2006 ou de Villers-au-Tertre en juillet 2010. Le roman, un matériau riche pour l'obstétrique / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 477 (Février 2017)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 477 (Février 2017) . - p. 32-34
Titre : Le roman, un matériau riche pour l'obstétrique Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Jérôme Janicki, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 32-34 Note générale : Cet article fait partie du dossier : "Histoire". Langues : Français (fre) Mots-clés : Obstétrique Grossesse Littérature Roman Représentations Résumé : A peine jetés de plain-pied dans 2018, les lecteurs sont déjà heureux de découvrir les nouveaux romans peuplés de nombreuses allusions à la grossesse et à l'accouchement. La nouvelle publication d'Anne AKRICH intitulée "Traité de savoir-rire à l'usage des embryons" publiée il y a quelques jours chez Julliard (234 pages) en est une preuve.
En effet, les romans sont une des sources majeures de l'historien de la médecine et de l'obstétrique. La littérature, avec ses décalages, ses parodies, ses témoignages ou ses anachronismes permet de nous interroger sur l'image de la grossesse et de l'accouchement. A l'inverse des représentations savantes données par le corps médical, dans les représentations artistiques, il n'y a aucun acte concret.
Les représentations dans la littérature sont des "ressemblances", elles ne s'adressent pas à un individu, ce ne sont pas des consultations, elles visent tantôt à divertir ou tantôt à suivre un schéma de construction pour le plus grand nombre. Les textes sont cependant un mélange de fiction, d'érudition et d'autobiographie. Ils partent d'une expérience de l'auteur ou de l'artiste, d'un fait divers, d'une histoire, d'une idée en vogue ; les idées sont ensuite véhiculées par l'écriture et les représentations se transforment en phénomènes observables par le plus grand nombre. Toutes ces représentations qui s'adressent à une échelle collective ont au final une incidence dans l'intimité de chacun et chacune.[article] Le roman, un matériau riche pour l'obstétrique [Livres, articles, périodiques] / Jérôme Janicki, Auteur . - 2018 . - p. 32-34.
Cet article fait partie du dossier : "Histoire".
Langues : Français (fre)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 477 (Février 2017) . - p. 32-34
Mots-clés : Obstétrique Grossesse Littérature Roman Représentations Résumé : A peine jetés de plain-pied dans 2018, les lecteurs sont déjà heureux de découvrir les nouveaux romans peuplés de nombreuses allusions à la grossesse et à l'accouchement. La nouvelle publication d'Anne AKRICH intitulée "Traité de savoir-rire à l'usage des embryons" publiée il y a quelques jours chez Julliard (234 pages) en est une preuve.
En effet, les romans sont une des sources majeures de l'historien de la médecine et de l'obstétrique. La littérature, avec ses décalages, ses parodies, ses témoignages ou ses anachronismes permet de nous interroger sur l'image de la grossesse et de l'accouchement. A l'inverse des représentations savantes données par le corps médical, dans les représentations artistiques, il n'y a aucun acte concret.
Les représentations dans la littérature sont des "ressemblances", elles ne s'adressent pas à un individu, ce ne sont pas des consultations, elles visent tantôt à divertir ou tantôt à suivre un schéma de construction pour le plus grand nombre. Les textes sont cependant un mélange de fiction, d'érudition et d'autobiographie. Ils partent d'une expérience de l'auteur ou de l'artiste, d'un fait divers, d'une histoire, d'une idée en vogue ; les idées sont ensuite véhiculées par l'écriture et les représentations se transforment en phénomènes observables par le plus grand nombre. Toutes ces représentations qui s'adressent à une échelle collective ont au final une incidence dans l'intimité de chacun et chacune.La sage-femme, l'accoucheur et le baptême intra-utérin / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 397 (Octobre 2010)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 397 (Octobre 2010) . - p. 35-38
Titre : La sage-femme, l'accoucheur et le baptême intra-utérin Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Jérôme Janicki, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 35-38 Langues : Français (fre) Mots-clés : Histoire Histoire professionnelle Profession de sage-femme Résumé : Cette question fondamentale fut au centre des préoccupations des théologiens, des chirurgiens et des accoucheurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Au cours des siècles qui précédèrent, tant au Moyen-Age qu'à l'époque moderne, le baptême des enfants mort-nés ou des nouveau-nés en grande difficultés se réglait simplement: la mère, la sage-femme ou le père se rendaient au sanctuaire à répit le plus proche du domicile et après quelques prières adressées à un saint local, l'enfant décédé redonnait quelques signes de vie, suffisamment pour qu'il soit baptisé. Mais certains envisagèrent la possibilité de baptiser directement le ftus en danger dans le ventre de sa mère. Au départ, les théologiens rejetèrent complètement cette méthode en s'appuyant sur les écrits de saint Thomas qui avait déjà plus ou moins tranché la question. Selon ses écrits "le baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une première naissance et il faut être né dans le monde pour renaître en Dieu". Ensuite, l'Eglise a marqué son ralliement progressif en acceptant le baptême intra-utérin tout en continuant à refuser la craniotomie - c'est-à-dire la tentative pour sauver la mère en sacrifiant l'enfant -. Enfin, des accoucheurs inventèrent un nouvel outil, la seringue à baptême pour baptiser directement le ftus dans le ventre de sa mère, un instrument utilisable partout et tout le temps. Depuis l'invention de la seringue, son évolution fut constante et elle n'a cessé d'être perfectionnée, mais rares sont ceux qui, au départ, imaginaient qu'elle deviendrait l'outil indispensable pour donner le sacrement du baptême. [article] La sage-femme, l'accoucheur et le baptême intra-utérin [Livres, articles, périodiques] / Jérôme Janicki, Auteur . - 2010 . - p. 35-38.
Langues : Français (fre)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 397 (Octobre 2010) . - p. 35-38
Mots-clés : Histoire Histoire professionnelle Profession de sage-femme Résumé : Cette question fondamentale fut au centre des préoccupations des théologiens, des chirurgiens et des accoucheurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Au cours des siècles qui précédèrent, tant au Moyen-Age qu'à l'époque moderne, le baptême des enfants mort-nés ou des nouveau-nés en grande difficultés se réglait simplement: la mère, la sage-femme ou le père se rendaient au sanctuaire à répit le plus proche du domicile et après quelques prières adressées à un saint local, l'enfant décédé redonnait quelques signes de vie, suffisamment pour qu'il soit baptisé. Mais certains envisagèrent la possibilité de baptiser directement le ftus en danger dans le ventre de sa mère. Au départ, les théologiens rejetèrent complètement cette méthode en s'appuyant sur les écrits de saint Thomas qui avait déjà plus ou moins tranché la question. Selon ses écrits "le baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une première naissance et il faut être né dans le monde pour renaître en Dieu". Ensuite, l'Eglise a marqué son ralliement progressif en acceptant le baptême intra-utérin tout en continuant à refuser la craniotomie - c'est-à-dire la tentative pour sauver la mère en sacrifiant l'enfant -. Enfin, des accoucheurs inventèrent un nouvel outil, la seringue à baptême pour baptiser directement le ftus dans le ventre de sa mère, un instrument utilisable partout et tout le temps. Depuis l'invention de la seringue, son évolution fut constante et elle n'a cessé d'être perfectionnée, mais rares sont ceux qui, au départ, imaginaient qu'elle deviendrait l'outil indispensable pour donner le sacrement du baptême. A la source des Vallois : le meurtre du nouveau-né capétien Jean 1er le Posthume ? / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 429 (Août-Septembre 2013)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 429 (Août-Septembre 2013) . - p. 36-39
Titre : A la source des Vallois : le meurtre du nouveau-né capétien Jean 1er le Posthume ? : Partie 11 Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Jérôme Janicki, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 36-39 Langues : Français (fre) Résumé : Entre l'époque des Mérovingiens et celle des Valois, les données sur les grossesses des reines de France ressemblaient à "un journal de bord déchiqueté" pour paraphraser Jean-Christophe Bailly. Or, à partir du XIVe siècle, la vie des reines enceintes est plus largement orchestrée par les chroniqueurs. Un rapprochement possible peut être envisagé avec le développement de la science obstétricale qui s'enrichit à cette époque d'opuscules plus "largement" diffusés qui contiennent en germe de nouvelles théories et de représentations de plus en plus riches qui s'invitent de fait dans nos archives. La prise en compte de ces nouveaux traités par les médecins pour suivre les grossesses des femmes de "bonne naissance" coïncide avec l'enrichissement des savoirs en médecine. Quelques exemples offrent un regard saisissant. [article] A la source des Vallois : le meurtre du nouveau-né capétien Jean 1er le Posthume ? : Partie 11 [Livres, articles, périodiques] / Jérôme Janicki, Auteur . - 2013 . - p. 36-39.
Langues : Français (fre)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 429 (Août-Septembre 2013) . - p. 36-39
Résumé : Entre l'époque des Mérovingiens et celle des Valois, les données sur les grossesses des reines de France ressemblaient à "un journal de bord déchiqueté" pour paraphraser Jean-Christophe Bailly. Or, à partir du XIVe siècle, la vie des reines enceintes est plus largement orchestrée par les chroniqueurs. Un rapprochement possible peut être envisagé avec le développement de la science obstétricale qui s'enrichit à cette époque d'opuscules plus "largement" diffusés qui contiennent en germe de nouvelles théories et de représentations de plus en plus riches qui s'invitent de fait dans nos archives. La prise en compte de ces nouveaux traités par les médecins pour suivre les grossesses des femmes de "bonne naissance" coïncide avec l'enrichissement des savoirs en médecine. Quelques exemples offrent un regard saisissant. L'utilisation de l'ergot de seigle par les sages-femmes et les accoucheurs ou comment terminer plus rapidement un accouchement grâce à la poudre obstétricale XVIIIe-XIXe siècle / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 402 (Mars 2011)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 402 (Mars 2011) . - p. 32-36
Titre : L'utilisation de l'ergot de seigle par les sages-femmes et les accoucheurs ou comment terminer plus rapidement un accouchement grâce à la poudre obstétricale XVIIIe-XIXe siècle Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Jérôme Janicki Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 32-36 Langues : Français (fre) Mots-clés : Accouchement Avortement provoqué Céréales Grossesse Histoire Résumé : Au détour d'un chemin, on découvre un champ de seigle aux épis couverts de drôles de bacchantes en guidon de vélo! Ces grosses taches qu'ils portent comme un sparadrap sur la peau, forment ce qu'on appelle l'ergot de seigle. Autrement dit, il s'agit d'une excroissance qui se développe sur le seigle et porte ce nom en raison de sa forme et de son mode d'implantation sur les épis. Pour comprendre comment apparaît l'ergot de seigle, il suffit de tracer une frontière sur la chronologie des climats, en inscrivant d'un côté les belles années et de l'autre les mauvaises, en ne gardant que celles où apparaissent des étés froids et humides. Le temps pluvieux favorise l'ergot qui envahit les épis. [article] L'utilisation de l'ergot de seigle par les sages-femmes et les accoucheurs ou comment terminer plus rapidement un accouchement grâce à la poudre obstétricale XVIIIe-XIXe siècle [Livres, articles, périodiques] / Jérôme Janicki . - 2011 . - p. 32-36.
Langues : Français (fre)
in Les Dossiers de l'Obstétrique > 402 (Mars 2011) . - p. 32-36
Mots-clés : Accouchement Avortement provoqué Céréales Grossesse Histoire Résumé : Au détour d'un chemin, on découvre un champ de seigle aux épis couverts de drôles de bacchantes en guidon de vélo! Ces grosses taches qu'ils portent comme un sparadrap sur la peau, forment ce qu'on appelle l'ergot de seigle. Autrement dit, il s'agit d'une excroissance qui se développe sur le seigle et porte ce nom en raison de sa forme et de son mode d'implantation sur les épis. Pour comprendre comment apparaît l'ergot de seigle, il suffit de tracer une frontière sur la chronologie des climats, en inscrivant d'un côté les belles années et de l'autre les mauvaises, en ne gardant que celles où apparaissent des étés froids et humides. Le temps pluvieux favorise l'ergot qui envahit les épis. La vie quotidienne des femmes enceintes durant la 2nde Guerre mondiale / Jérôme Janicki in Les Dossiers de l'Obstétrique, 389 (Janvier 2010)
Permalink