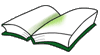A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
Détail de l'auteur
Auteur Annick Anchisi
Documents disponibles écrits par cet auteur


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheCadres et qualité : à la recherche des soins infirmiers / Annick Anchisi in Recherche en soins infirmiers, 77 (Juin 2004)
in Recherche en soins infirmiers > 77 (Juin 2004) . - p. 41-55
Titre : Cadres et qualité : à la recherche des soins infirmiers Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Annick Anchisi, Auteur ; Elvire Berra, Auteur ; Murielle Pott, Auteur Année de publication : 2004 Article en page(s) : p. 41-55 Langues : Français (fre) Mots-clés : gestion de la qualité cadre infirmier représentation organisation du travail Résumé : La gestion de la qualité mobilise tous les acteurs des établissements de santé à des degrés divers. Les cadres infirmiers sont des éléments clés pour la réalisation de ces programmes. A travers le discours des cadres, cet article explore les liens entre la gestion de la qualité et les soins infirmiers. Les entretiens menés montrent que la qualité est surinvestie par les cadres, ainsi elle va répondre aux problèmes de l'organisation du travail et permettre, secondairement, une reconnaissance professionnelle. L'analyse met en évidence que les valeurs de la qualité se superposent à celle d'une conception pragmatique des soins basée sur une vision disjonctive, linéaire et atemporelle. Par ailleurs, les soins infirmiers ne sont pas considérés comme une discipline, les soins de qualité ne sont pas définis. Les recommandations se concentrent sur le rôle du manager et en particulier sur la définition a priori des problèmes prioritaires des différents services. [article] Cadres et qualité : à la recherche des soins infirmiers [Livres, articles, périodiques] / Annick Anchisi, Auteur ; Elvire Berra, Auteur ; Murielle Pott, Auteur . - 2004 . - p. 41-55.
Langues : Français (fre)
in Recherche en soins infirmiers > 77 (Juin 2004) . - p. 41-55
Mots-clés : gestion de la qualité cadre infirmier représentation organisation du travail Résumé : La gestion de la qualité mobilise tous les acteurs des établissements de santé à des degrés divers. Les cadres infirmiers sont des éléments clés pour la réalisation de ces programmes. A travers le discours des cadres, cet article explore les liens entre la gestion de la qualité et les soins infirmiers. Les entretiens menés montrent que la qualité est surinvestie par les cadres, ainsi elle va répondre aux problèmes de l'organisation du travail et permettre, secondairement, une reconnaissance professionnelle. L'analyse met en évidence que les valeurs de la qualité se superposent à celle d'une conception pragmatique des soins basée sur une vision disjonctive, linéaire et atemporelle. Par ailleurs, les soins infirmiers ne sont pas considérés comme une discipline, les soins de qualité ne sont pas définis. Les recommandations se concentrent sur le rôle du manager et en particulier sur la définition a priori des problèmes prioritaires des différents services. L?expérience indicible du dégoût dans les soins / Annick Anchisi in Soins gérontologie, N°171 (Janvier 2025)
in Soins gérontologie > N°171 (Janvier 2025) . - p. 19-23
Titre : L?expérience indicible du dégoût dans les soins Type de document : Rapport de stage Auteurs : Annick Anchisi Année de publication : 2025 Article en page(s) : p. 19-23 Langues : Français (fre) Résumé : Le corps-à-corps qu?exige la relation de soins est peu théorisé du point de vue de l?expérience du dégoût des soignants et de leurs stratégies pour y faire face. Parfois évoqué dans les coulisses de l?entre-soi, sur le devant de la scène, le dégoût reste un interdit, sorte de ?coup de canif? à la morale professionnelle. Forgée dans l?importance de la relation et du respect de l?autre, la relation de soins fait peu de place à cet éprouvé. La situation de soins palliatifs d?une patiente de 70 ans atteinte d?un cancer très invasif pour lequel les odeurs étaient particulièrement nauséabondes lève le voile sur une réalité fréquente de la relation de soins : le dégoût des corps soignés. Au-delà de l?exceptionnalité de cette situation, il convient de comprendre en quoi elle éclaire le lieu anthropologique que représente une situation de soins. Note de contenu : DOI: https://doi.org/10.1016/j.sger.2024.10.003
Cet article fait partie du dossier "La prise en soin du vieillissement".[article] L?expérience indicible du dégoût dans les soins [Rapport de stage] / Annick Anchisi . - 2025 . - p. 19-23.
Langues : Français (fre)
in Soins gérontologie > N°171 (Janvier 2025) . - p. 19-23
Résumé : Le corps-à-corps qu?exige la relation de soins est peu théorisé du point de vue de l?expérience du dégoût des soignants et de leurs stratégies pour y faire face. Parfois évoqué dans les coulisses de l?entre-soi, sur le devant de la scène, le dégoût reste un interdit, sorte de ?coup de canif? à la morale professionnelle. Forgée dans l?importance de la relation et du respect de l?autre, la relation de soins fait peu de place à cet éprouvé. La situation de soins palliatifs d?une patiente de 70 ans atteinte d?un cancer très invasif pour lequel les odeurs étaient particulièrement nauséabondes lève le voile sur une réalité fréquente de la relation de soins : le dégoût des corps soignés. Au-delà de l?exceptionnalité de cette situation, il convient de comprendre en quoi elle éclaire le lieu anthropologique que représente une situation de soins. Note de contenu : DOI: https://doi.org/10.1016/j.sger.2024.10.003
Cet article fait partie du dossier "La prise en soin du vieillissement".Les personnes âgées atteintes de démence en établissement médico-social : défis quotidiens pour les soignantes. / Annick Anchisi in Recherche en soins infirmiers, 72 (Mars 2003)
in Recherche en soins infirmiers > 72 (Mars 2003) . - p. 48-120
Titre : Les personnes âgées atteintes de démence en établissement médico-social : défis quotidiens pour les soignantes. : Avec la collaboration scientifique de Valérie Hugentobler et François Höpfinger, Institut Universitaire âges et générations. Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Annick Anchisi, Auteur ; Christine Desnouveaux, Auteur ; Nadia Ebenegger, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 48-120 Langues : Français (fre) Mots-clés : démence personnes âgées établissement de longs séjours infirmière aide soignante représentations temps interactions sécurité professionnelle offre en soins satisfaction Résumé : Dans le cadre d'un partenariat avec des EMS du Valais romand, cette recherche a mis en évidence certaines caractéristiques de la prise en soins des personnes âgées atteintes de démence. Les entretiens ont été réalisés avec deux groupes professionnels : 19 aides-soignantes certifiées (AS) et 19 infirmières diplômées (ID). Le champ des soins a été investigué sous les angles des représentations psychosociales, du temps, de la sécurité professionnelle, des interactions, de l'offre en soins et de la satisfaction au travail.
Pour les AS, les représentations de la vieillesse et de la démence se confondent et reconduisent le sens commun. Les ID se réfèrent à un idéal professionnel qui a pour conséquence une indifférenciation des individus soignés. Ainsi pour les deux groupes de professionnelles, les représentations permettent une mise à distance protectrice mais servent aussi d'écran à la diversité des situations des personnes âgées démentes. Concernant le temps, face à la masse de travail à effectuer, les AS et les ID privilégient l'efficacité et l'utilisation du temps est rarement questionné sous l'angle de sa finalité. Les soignantes inscrivent donc principalement leurs actions dans la logique de la tâche sous l'angle de sa finalité. Les soignantes inscrivent donc principalement leurs actions dans une logique de la tâche et du contrôle rendant ainsi d'abord service au système institutionnel, largement inspiré du modèle hospitalier. Face aux comportements hors normes des pensionnaires déments, le risque d'agression physique ressort du discours des AS alors que l'imprévisibilité des situations de soins est centrale pour les ID. Le manque de sécurité est également relatif aux connaissances lacunaires des professionnelles concernant les démences et la prise en charge spécifique qu'elles requièrent. Les interactions, bien que décrites comme essentielles par les AS et les ID, ne sont pas considérées comme thérapeutiques et la parole joue prioritairement un rôle fonctionnel. L'offre en soins est commune aux deux groupes. Elle se limite principalement à la satisfaction des besoins physiologiques. Le projet de soins répond davantage aux attentes institutionnelles qu'à une réelle offre en soins individualisée. Les AS et les ID se disent très satisfaites de leur travail auprès des personnes démentes. La satisfaction est vue prioritairement sous les angles de l'utilité et de l'idéal professionnel. En résumé, la spécificité de la prise en soins est d'abord relative au (architecture, composition du personnel, type de population) et ne dépend que très secondairement du type de formation suivie par les professionnelles.[article] Les personnes âgées atteintes de démence en établissement médico-social : défis quotidiens pour les soignantes. : Avec la collaboration scientifique de Valérie Hugentobler et François Höpfinger, Institut Universitaire âges et générations. [Livres, articles, périodiques] / Annick Anchisi, Auteur ; Christine Desnouveaux, Auteur ; Nadia Ebenegger, Auteur . - 2003 . - p. 48-120.
Langues : Français (fre)
in Recherche en soins infirmiers > 72 (Mars 2003) . - p. 48-120
Mots-clés : démence personnes âgées établissement de longs séjours infirmière aide soignante représentations temps interactions sécurité professionnelle offre en soins satisfaction Résumé : Dans le cadre d'un partenariat avec des EMS du Valais romand, cette recherche a mis en évidence certaines caractéristiques de la prise en soins des personnes âgées atteintes de démence. Les entretiens ont été réalisés avec deux groupes professionnels : 19 aides-soignantes certifiées (AS) et 19 infirmières diplômées (ID). Le champ des soins a été investigué sous les angles des représentations psychosociales, du temps, de la sécurité professionnelle, des interactions, de l'offre en soins et de la satisfaction au travail.
Pour les AS, les représentations de la vieillesse et de la démence se confondent et reconduisent le sens commun. Les ID se réfèrent à un idéal professionnel qui a pour conséquence une indifférenciation des individus soignés. Ainsi pour les deux groupes de professionnelles, les représentations permettent une mise à distance protectrice mais servent aussi d'écran à la diversité des situations des personnes âgées démentes. Concernant le temps, face à la masse de travail à effectuer, les AS et les ID privilégient l'efficacité et l'utilisation du temps est rarement questionné sous l'angle de sa finalité. Les soignantes inscrivent donc principalement leurs actions dans la logique de la tâche sous l'angle de sa finalité. Les soignantes inscrivent donc principalement leurs actions dans une logique de la tâche et du contrôle rendant ainsi d'abord service au système institutionnel, largement inspiré du modèle hospitalier. Face aux comportements hors normes des pensionnaires déments, le risque d'agression physique ressort du discours des AS alors que l'imprévisibilité des situations de soins est centrale pour les ID. Le manque de sécurité est également relatif aux connaissances lacunaires des professionnelles concernant les démences et la prise en charge spécifique qu'elles requièrent. Les interactions, bien que décrites comme essentielles par les AS et les ID, ne sont pas considérées comme thérapeutiques et la parole joue prioritairement un rôle fonctionnel. L'offre en soins est commune aux deux groupes. Elle se limite principalement à la satisfaction des besoins physiologiques. Le projet de soins répond davantage aux attentes institutionnelles qu'à une réelle offre en soins individualisée. Les AS et les ID se disent très satisfaites de leur travail auprès des personnes démentes. La satisfaction est vue prioritairement sous les angles de l'utilité et de l'idéal professionnel. En résumé, la spécificité de la prise en soins est d'abord relative au (architecture, composition du personnel, type de population) et ne dépend que très secondairement du type de formation suivie par les professionnelles.Toucher un résident âgé atteint de démence : une évidence aux multiples facettes / Corinne Schaub in Recherche en soins infirmiers, 111 (Décembre 2012)
in Recherche en soins infirmiers > 111 (Décembre 2012) . - p. 44-56
Titre : Toucher un résident âgé atteint de démence : une évidence aux multiples facettes Type de document : Livres, articles, périodiques Auteurs : Corinne Schaub, Auteur ; Marie-Christine Follonier, Auteur ; Catherine Borel, Auteur ; Annick Anchisi, Auteur ; Nicolas Kuhne, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 44-56 Langues : Français (fre) Mots-clés : toucher soins infirmiers démence personnes âgées Résumé : Introduction : Le toucher et le massage simple font partie des interventions non pharmacologiques de première intention dans la prise en charge globale des soins aux personnes âgées démentes (PAD).
Contexte : Ces gestes ont des effets favorables aussi bien sur le niveau d’anxiété et d’estime de soi des PAD que sur la qualité de la relation. Ils sont néanmoins pratiqués de manière très inégale par les soignants alors que cette population requiert de nombreux soins corporels.[article] Toucher un résident âgé atteint de démence : une évidence aux multiples facettes [Livres, articles, périodiques] / Corinne Schaub, Auteur ; Marie-Christine Follonier, Auteur ; Catherine Borel, Auteur ; Annick Anchisi, Auteur ; Nicolas Kuhne, Auteur . - 2012 . - p. 44-56.
Langues : Français (fre)
in Recherche en soins infirmiers > 111 (Décembre 2012) . - p. 44-56
Mots-clés : toucher soins infirmiers démence personnes âgées Résumé : Introduction : Le toucher et le massage simple font partie des interventions non pharmacologiques de première intention dans la prise en charge globale des soins aux personnes âgées démentes (PAD).
Contexte : Ces gestes ont des effets favorables aussi bien sur le niveau d’anxiété et d’estime de soi des PAD que sur la qualité de la relation. Ils sont néanmoins pratiqués de manière très inégale par les soignants alors que cette population requiert de nombreux soins corporels.